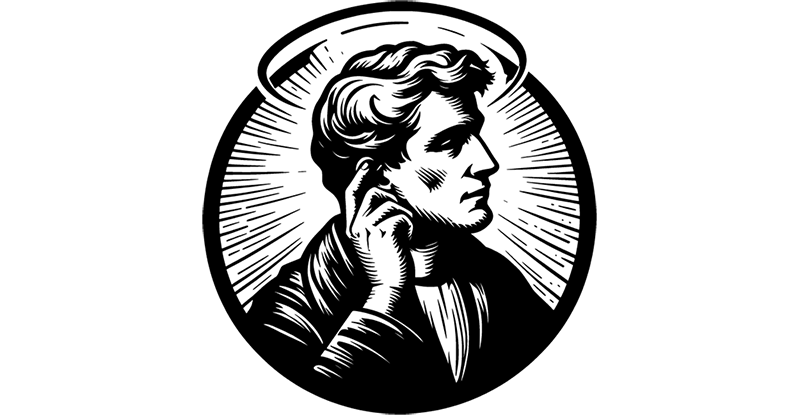AFAN
Association francophone des amis de Newman
Créée en 1982, l’Association a pour but de mieux faire connaître la pensée et l’œuvre de Newman dans les pays de langue française, à travers traductions, études et autres activités.
Elle est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à Newman – universitaires, étudiants, laïcs, prêtres, religieux/ses, spécialistes ou amateurs – et qui désirent soit participer à ce travail de diffusion de sa pensée et de son œuvre, soit simplement mieux le connaître.
Les ressources Newmaniennes
Découvrez Newman à travers nos ressources variées
Études
Actes des colloques newmaniens, études, documents, ...
Outils de référence
Ressources pour les chercheurs
Sites newmaniens
Associations newmaniennes non francophones
Vidéos & Podcasts
Podcasts de l'association, retransmission de colloques, ...
John Henry Newman est un saint, un écrivain et un penseur qui a marqué l’histoire du christianisme au XIXe siècle.
Dernières actualités
Retrouvez toutes les dernières actualités de l'association
Promenade newmanienne n°2 : La conscience
- 02/11/2025
Chers amis de Newman, Rejoignez-nous pour la deuxième Promenade newmanienne® le vendredi 7/11 à 18h sur Zoom ! La promenade de l'après-midi était presque...
Conférence "Newman, un guide pour l'Espérance"
- 02/11/2025
Le 21 novembre prochain, à 20h, Olivier Joncquez donnera une conférence intitulée "Newman, un guide pour l'Espérance" à la maison diocésaine Les...
[Replay] Direct de la place St Pierre
- 01/11/2025
Cette célébration diffusée en direct sur KTO peut être visionnée en intégralité pendant une semaine, et à la suite de cette...